L’UNESCO
vient de classer les tablettes de bois de la pagode Vĩnh Nghiêm, dans la
province de Bac Giang, au patrimoine documentaire de la région Asie-Pacifique.
Ces tablettes succèdent ainsi à celles de la dynastie des Nguyen et aux stèles
en pierre du temple de la Littérature à Hanoï. Il s’agit d’ailleurs des uniques
planches xylographiques du canon Truc Lam, la secte zen la plus représentative
du bouddhisme vietnamien. La plus vieille daterait du XIIIe siècle et la plus
récente, pas plus tard que du début du XXe siècle.
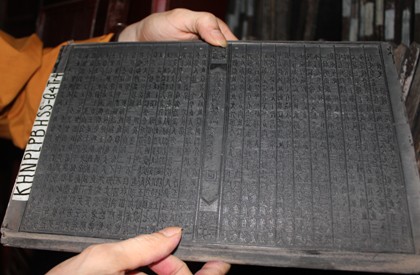 La
pagode Vĩnh Nghiêm a été construite au XIe siècle, sous la dynastie des Ly.
Au XIIIe siècle, sous la dynastie des Tran, les trois fondateurs de la secte
zen Truc Lam, à savoir Tran Nhan Tong, Phap Loa et Huyen Quang, l’ont élargie
pour en faire un lieu de formation de bonzes. Les architectures qui subsistent
encore à nos jours remontent aux dynasties des Le et des Nguyen, soit entre le
XVe et le début du XXe siècle. Les objets antiques conservés dans la pagode
sont d’une diversité exceptionnelle : une bonne centaine de statues de
Bouddha, une reproduction de la grotte Huong Tich, une énorme cloche, un
ensemble de 7 stèles en pierre, et bien sûr, ces fameuses tablettes de bois
servant à l’impression des canons bouddhiques, les plus importants du Vietnam.
Le vénérable Thích Thanh Vịnh, vice-gérant de la pagode Vĩnh Nghiêm nous a
confié : « En tant que centre de formation bouddhiste sous la
dynastie des Tran, la pagode Vĩnh Nghiêm s’est livrée très tôt à la
xylographie, dès le début du XVe siècle. Elle conserve d’ailleurs plus de
3000 planches servant à l’impression du canon, de la loi et de la théorie
bouddhiques. Ces planches sont disposées sur 7 étals. Leur valeur réside non
seulement dans leur contenu, mais aussi dans l’art xylographique des dynasties
des Tran, Le et Nguyen. C’est un art sophistiqué qui demande beaucoup de
travail. »
La
pagode Vĩnh Nghiêm a été construite au XIe siècle, sous la dynastie des Ly.
Au XIIIe siècle, sous la dynastie des Tran, les trois fondateurs de la secte
zen Truc Lam, à savoir Tran Nhan Tong, Phap Loa et Huyen Quang, l’ont élargie
pour en faire un lieu de formation de bonzes. Les architectures qui subsistent
encore à nos jours remontent aux dynasties des Le et des Nguyen, soit entre le
XVe et le début du XXe siècle. Les objets antiques conservés dans la pagode
sont d’une diversité exceptionnelle : une bonne centaine de statues de
Bouddha, une reproduction de la grotte Huong Tich, une énorme cloche, un
ensemble de 7 stèles en pierre, et bien sûr, ces fameuses tablettes de bois
servant à l’impression des canons bouddhiques, les plus importants du Vietnam.
Le vénérable Thích Thanh Vịnh, vice-gérant de la pagode Vĩnh Nghiêm nous a
confié : « En tant que centre de formation bouddhiste sous la
dynastie des Tran, la pagode Vĩnh Nghiêm s’est livrée très tôt à la
xylographie, dès le début du XVe siècle. Elle conserve d’ailleurs plus de
3000 planches servant à l’impression du canon, de la loi et de la théorie
bouddhiques. Ces planches sont disposées sur 7 étals. Leur valeur réside non
seulement dans leur contenu, mais aussi dans l’art xylographique des dynasties
des Tran, Le et Nguyen. C’est un art sophistiqué qui demande beaucoup de
travail. »
Ces
plus de 3000 tablettes de bois reproduisent 34 livres propageant l’esprit du
bouddhisme du Grand Véhicule, tel qu’il est perçu par les trois fondateurs de
la secte zen Truc Lam, et qu’on peut résumer par une intégration de Bouddha
dans la vie quotidienne. Cette philosophie encourage l’autonomie et la
confiance en soi-même. Elle conseille à ses adeptes de ne pas compter sur les
forces divines, d’être optimistes dans la vie quotidienne et de respecter la
loi de la nature. La naissance de la secte zen Truc Lam, au XIIIe siècle, a
marqué le début d’une vietnamisation du bouddhisme importé d’Inde et de Chine.
Et il faut savoir que les tablettes de bois conservées dans la pagode Vĩnh
Nghiêm sont les seules planches servant à imprimer le canon Truc Lam qui
existent encore aujourd’hui. C’est d’ailleurs pour cette unicité qu’elles ont
été classées par l’UNESCO au patrimoine documentaire. Selon Trần Văn Lạng,
directeur du musée de Bac Giang, les grandes lignes de la secte zen Truc Lam se
trouvent dans les planches reproduisant « le journal d’Yên Tu »,
datant de la fin du XVIe siècle: « Certaines autres pagodes comme
Bổ Đà ou Vân Hà conservent aussi des tablettes de bois, mais ces tablettes ne
contiennent que le canon bouddhique, et pas du tout ce livre. Or, la secte zen
Truc Lam avait son propre dogme qui devait être propagé dans la société par le
biais des livres. Les fondateurs de la secte se sont inspirés des canons indien
et chinois pour créer leur propre courant religieux en y ajoutant l’identité
vietnamienne. Tran Nhan Tong a dit : « pour devenir un bouddha, il
faut d’abord savoir se maîtriser soi-même » ou encore : pour
atteindre l’éveil, on peut rester chez soi sans aller en haute montagne, dans
une pagode ou dans un institut zen. »
Les
tablettes de Vĩnh Nghiêm sont faites avec du bois de plaqueminier qui provient
tout simplement du jardin de la pagode. Ce bois correspond parfaitement à la
gravure. Il est à la fois doux mais résistant, facile à graver mais solide, et
surtout, il gauchit peu. Les gravures contiennent des idéogrammes chinois ou
sino-vietnamiens à l’envers, sortes de négatif, et parfois des motifs de
décoration d’une harmonie remarquable. Les planches qui subsistent encore de
nos jours sont toutes couvertes d’une épaisse couche d’encre noire luisante,
profondément intégrée dans les fibres du bois, témoignant du nombre
incalculable d’impressions auxquelles elles ont servi. Les idéogrammes sont
d’un style épuré, leur beauté simple a résisté aux affres du temps. A voir ces planches
vieilles de plusieurs centaines d’années, on ne peut s’empêcher d’éprouver une
grande admiration pour le talent, la patience et le dévouement de ceux qui les
ont créées. Et ce n’est certainement pas Nguyễn Văn Phong, chercheur en
idéogrammes chinois et sino-vietnamiens de formation, et directeur adjoint du
musée de Bac Giang qui nous fera changer d’avis : « Au Vietnam,
rares étaient les corporations qui pratiquaient ce métier de xylographes. La
plus connue était celle de Hai Duong. A la pagode Vĩnh Nghiêm, nous avons
trouvé des planches où, sur une superficie d’un cm2 seulement, l’artisan avait
gravé 4 à 5 idéogrammes qui contiennent jusqu’à 20 traits chacun, pour certains
d’entre eux. A l’époque, pour pouvoir pratiquer ce métier, il fallait être à la
fois dévoué et instruit. Chaque corporation comprenait de nombreux artisans,
mais toutes les planches qu’ils ont produites étaient impeccables, ce qui
prouve leur savoir-faire et leur sens des responsabilités. »
A
noter aussi que pour achever une planche, un artisan qualifié et instruit de
l’époque devait passer au moins 2 mois. Le canon Hoa Nghiêm par exemple, qui
comprend 200 planches achevées en 1884, a coûté plus de 70 ans de travail. Les
xylographes de la pagode Vĩnh Nghiêm étaient réputés pour leur perfectionnisme:
il suffisait que 2 ou 3 idéogrammes présentent de petits défauts pour jeter
toute la planche. A recommencer à zéro. On raconte d’ailleurs que certains
artisans n’ont pas pu finir la gravure d’un canon avant de mourir, et que
certains canons ont nécessité le travail de plus de 3 générations. Chaque
planche est une œuvre artistique sophistiquée, et les plus de 3000 tablettes de
bois, héritées et conservées par 59 générations de gérants de la pagode Vĩnh
Nghiêm sont autant d’archives précieuses pour qui serait intéressé par la
xylographie vietnamienne sous les dynasties des Le et des Nguyen.